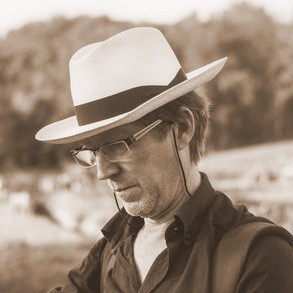Intervenants

Biogéochimiste de formation et titulaire d’un doctorat en écologie fonctionnelle, je dirige actuellement la société Soltis Environnement.
Au cours des10 dernières années, j’ai coordonné pour le compte d’acteurs publics et privés différentes études dont l’objectif est d’évaluer la vulnérabilité des milieux naturels et des usages socio-économiques dans un contexte de pressions climatiques et anthropiques croissantes. J’ai également développé des outils permettant d’améliorer la prise en compte de la biodiversité, des fonctions et services rendus dans le réaménagement des sites dégradés et pollués et la préservation / restauration des zones humides.
Mes missions actuelles visent à améliorer la prise en compte de la qualité des sols, notamment biologique, dans le cadre de la réhabilitation écologique des écosystèmes ou de la planification territoriale.

Philippe Bataillard est chercheur en Science du Sol au BRGM depuis 2006. Son expertise scientifique porte sur la compréhension des processus responsables de la formation du sol et de leur impact sur la mobilité des polluants. Il travaille depuis de nombreuses années à lever les freins à la mise en place d’un « petit cycle des terres » en milieu urbain, un cycle anthropique dédié aux matériaux terreux qui vise leur réemploi local le plus systématique possible, et notamment, en sol fonctionnel. En parallèle de son activité de recherche, il mène des expertises pour le compte de l’Etat sur les problématiques de la gestion des sédiments et de la valorisation des déchets terreux en conditions de surface. Membre de l’Association Française d’Etude du Sol, Philippe Bataillard est également directeur scientifique du GISFI (Groupement d’intérêt Scientifique sur les Friches Industrielles) depuis 2020.

Colette Bertrand est chargée de recherche en agroécotoxicologie à l’INRAE, dans l’unité de recherche EcoSys à Palaiseau. Ses recherches, qui intègrent à l’écotoxicologie des connaissances de l’écologie du paysage et de l’écologie des communautés, visent à fournir de nouvelles connaissances pour évaluer et gérer les risques associés à la pollution par les pesticides. Il s’agit plus précisément d’améliorer, en contexte agricole, la compréhension et la prédiction de l’exposition d’organismes non-cibles aux pesticides à l’échelle du paysage, et d’étudier les effets non-intentionnels qui en découlent.
Colette coordonne actuellement le projet de recherche MixTox (financement ADEME, 2022 – 2026), qui vise à caractériser la contamination de sols agricoles par les pesticides, et à évaluer les effets indésirables sur la survie, la croissance, la reproduction ou le comportement d’organismes non-cibles (vers de terre, carabes, escargots). En combinant des approches de terrain et de laboratoire, l’un des objectifs de ce projet est d’essayer d’identifier des indicateurs et/ou des bioindicateurs (d’usage, d’exposition ou d’impact) de l’écotoxicité des sols.

Philippe Billet est professeur agrégé de droit public (U. Jean Moulin – Lyon 3) et Directeur de l’Institut de droit de l’environnement (CNRS, UMR 5600, EVS-IDE – U. Lyon). Il étudie sous l’angle juridique la protection des sols et les services écosystémiques associés ainsi que la protection de la biodiversité depuis une trentaine d’années. Vice-président de l’Association française pour l’étude du sol (AFES) et du Comité scientifique de la Fondation de la recherche pour la biodiversité (FRB), il est également membre du Comité Scientifique, Technique et d’Innovation du Réseau National d’Expertise Scientifique et Technique sur les Sols (RNEST).

Après une première partie de carrière comme enseignant-chercheur à l’Université de Paris-Sud, Thierry Caquet a rejoint l’INRA de Rennes en 2001. De 2013 à 2017, il a été Chef du Département d’écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques et Directeur du métaprogramme sur l’adaptation au changement climatique de l’agriculture et de la forêt de l’INRA. Depuis juin 2017, il est Directeur Scientifique Environnement et membre du collège de direction de l’INRA, devenu INRAE en 2020. A ce titre, il coordonne les activités de l’Institut dans les domaines du changement climatique (atténuation et adaptation), de la biodiversité, de la gestion durable des ressources naturelles et des risques naturels et environnementaux.
Thierry Caquet est membre du Comité de pilotage scientifique de l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement (AllEnvi), du Conseil d’Administration de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB), du Conseil scientifique de l’Agence de la transition écologique (Ademe) et du Conseil scientifique et technique de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).

Matthieu Chauvat est enseignant-chercheur en biologie des sols depuis 2006 à l’Université de Rouen Normandie où il enseigne l’écologie des sols. Il s’intéresse aux relations qu’entretiennent entre-eux les plantes et la faune du sol. Plus particulièrement spécialisé dans l’étude des microarthropodes (Collemboles et Acariens) du sol, il a participé à de multiples projets à l’échelle nationale et régionale dédiés, entre-autres, à l’étude des relations entre système agricole et santé des sols conduisant à la publication de plus de 70 articles dans des revues internationales et à une plus d’une cinquantaine de communications lors de manifestations scientifiques internationales.

Docteur en agroécologie depuis 2015, Camille Chauvin est ingénieur de recherche à ELISOL Environnement. Il contribue à la production du laboratoire en maintenant une interaction étroite avec les clients. Il est fortement impliqué dans des projets de R&D visant à développer des outils de bio-indication pour évaluer la santé des sols en s’appuyant sur l’étude des nématodes du sol. En tant que formateur, il s’engage à mieux faire connaître les sols et les outils de bio-indication auprès de tous les usagers.
ELISOL environnement est une entreprise à l’ancrage scientifique solide, spécialisée dans la santé des sols et des plantes. Reconnue à l’échelle internationale pour son expertise sur les nématodes du sol, ELISOL fournit à ses clients des analyses biologiques permettant d’évaluer et de surveiller la santé biologique des sols. Ces diagnostics s’appuient sur l’étude des nématodes, bio-indicateurs essentiels de la qualité biologique des sols.
Au-delà de son rôle d’expert en diagnostic biologique, ELISOL est également un laboratoire d’analyses phytonématologiques, un centre de recherche et développement, ainsi qu’un organisme de formation certifié Qualiopi, contribuant ainsi activement à l’innovation et à la formation.

Nicolas CHEMIDLIN PREVOST-BOURE est professeur d’écologie microbienne et Directeur de la Recherche et de la Valorisation à l’Institut Agro Dijon, il réalise ses activités de recherche au sein de l’équipe Biocom de l’UMR Agroécologie. Spécialisé en écologie des communautés microbiennes des sols, il s’intéresse particulièrement à leur biogéographie pour mieux comprendre leur dynamiques spatiales et temporelles en lien avec les facteurs de l’environnement et les pratiques agricoles à des échelles paysagères. De manière plus finalisée, il les intègre dans des approches pluridisciplinaires visant à contribuer à la durabilité des filières agri-alimentaires. Il a contribué à plusieurs chapitres d’ouvrages et ouvrages dont l’Atlas français des bactéries du sol (https://leclub-biotope.com/fr/librairie-naturaliste/1076-atlas-francais-des-bacteries-du-sol; 2018), et anime des projets de recherche fondamentale et collaboratifs impliquant des acteurs du monde agricole et des filières agri-alimentaires.

Daniel Cluzeau – UMR ECOBIO (Univ.Rennes & CNRS)
40 ans de recherches pluridisciplinaires & finalisées sur les interactions entre pratiques de gestion des sols & conditions d’assemblage de la biodiversité lombricienne (du local à l’Europe) selon 3 axes principaux.
Axe 1 – Lombriciens comme groupes de réponse aux changements d’usage et de gestion des sols
- Evaluation des impacts des activités humaines sur les assemblages des communautés lombriciennes dans des systèmes très perturbés : des sols agricoles aux sols urbains, voire complètement artificialisés.
- Démarche de validation des lombriciens comme bioindicateur de réponse aux contraintes anthropiques.
Axe 2 – Lombriciens comme groupes fonctionnels d’impact
- Contribution à l’écologie du sol via les interactions entre états structuraux des sols, bioturbation lombricienne, transfert de carbone et activités microbiennes.
- Caractérisation de la complémentarité fonctionnelle entre ces groupes lombriciens.
Axe 3 – Diffusion d’outils opérationnels et démarche participative (développement de la séquence E-R-C)
- Participation au transfert d’une boite à outils opérationnelle permettant d’évaluer l’état patrimonial ou fonctionnel de la biodiversité des sols
- Développement & valorisation d’écotechniques permettant la conservation ou la restauration des populations lombriciennes (via les corridors de la Trame Brune)
- Depuis 2011, création & coordination de l’OPVT (http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_accueil.php) qui permet une évaluation nationale et européenne de (1) l’impact des activités humaines sur l’assemblages de ces communautés et (2) des processus de restauration de ces communautés lombriciennes après changement de pratiques et de mode de gestion.

Isabelle Cousin est directrice de recherche INRAE, dans l’Unité de recherche Info&Sols à Orléans. Physicienne du sol, elle développe des recherches sur les échanges hydriques et gazeux entre les sols, l’air, et les cultures. Depuis une dizaine années, ses travaux concernent également les services de régulation rendus par les sols agricoles, en particulier la régulation du climat et la capacité des sols à stocker et restituer de l’eau, vers les plantes ou les aquifères. Ses recherches visent ainsi à apporter des propositions opérationnelles dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource en eau en agriculture via, notamment, la maîtrise de l’irrigation et, de façon plus générale, dans le domaine de la gestion durable des agro-écosystèmes. Ces dernières années, elle a également développé des activités plus larges sur la protection des sols : elle a coordonné un projet européen et une étude nationale sur la mise au point et la cartographie, aux échelles nationale et européenne, d’indicateurs de qualité et de santé des sols.

Samuel Dequiedt est Ingénieur d’Etudes au sein de l’UMR AgroEcologie. Depuis plus de 15 ans, il s’investit dans les travaux de recherche portant sur la diversité microbienne des sols. Fort d’une expertise en écologie microbienne et en analyse/fouille de données, il est historiquement impliqué dans les travaux portant sur l’écologie microbienne des sols permettant de mieux comprendre les paramètres et pratiques agricoles influençant les modifications de diversité microbienne mais aussi le développement de bioindicateurs opérationnels de la qualité microbiologique des sols. Ces travaux permettent aujourd’hui de réaliser un transfert de connaissance ainsi qu’un diagnostic permettant d’évaluer les pratiques agricoles et de travailler avec le monde agricole, via des projets de Science Participative, dans la transition agroécologique.

Virginie Derycke est géochimiste de formation. Après avoir réalisé une thèse en environnement minier et acquis de l’expérience dans un bureau d’études spécialisé en gestion des sites et sols pollués, elle travaille depuis près de 10 ans au BRGM. En tant qu’experte en gestion des sites et sols pollués, elle contribue à la fois à des actions d’appui aux politiques publiques et à des projets de recherche. Ses travaux de recherche portent sur l’intégration de la biodiversité et de la santé des sols dans la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. De plus, elle est formatrice depuis près de 10 ans sur la mise en œuvre des outils de gestion des sites et sols pollués.

Olivier DEVICTOR, après avoir réalisé des études au lycée agricole de Hyères et ensuite au lycée agricole de Montpellier, s’est surtout spécialisé dans le machinisme agricole et œnologie.
Avant de reprendre le domaine familial avec mon grand frère en 2001, j’ai effectué un séjour de 6 mois pour vinifier en Afrique du Sud.
Il a transformé l’exploitation en s’orientant sur l’Agroécologie.
Dans le Var la pluviométrie étant faible et mal répartie dans l’année, il s’est passionné pour la biologie des sols et l’économie d’eau grâce au couvert végétal de ceci. En liaison avec l’INRA de Dijon, il a supervisé plusieurs essais d’implantation de différentes espèces de plantes.
Au cours de ces journées, Olivier vous fera partager sa passion !

Céline Emberger travaille sur les écosystèmes forestiers au sein du Conservatoire d’espaces naturels Occitanie depuis 2022. Elle commence à sillonner les bois en 2009, pour ne plus en sortir jusqu’à présent…. Après avoir participé à des projets de recherche à INRAE sur l’écologie des forêts méditerranéennes et de montagne, elle a œuvré à l’accompagnement des propriétaires privés dans leur gestion et en particulier à la prise en compte de la biodiversité au sein du CNPF, avant de rejoindre le CEN. Elle s’intéresse aux problématiques de gestion forestière durable à long terme, en particulier en lien avec l’écologie du sol et la biodiversité taxonomique ordinaire.
A l’interface entre recherche et gestion, préservation de fonctionnalités et sylviculture raisonnée, elle a à cœur de concilier les usages forestiers et de faciliter le dialogue entre acteurs pour conforter la durabilité de nos gestions. Elle participe à différentes actions : accompagnement à l’acquisition de forêt à enjeux de conservation ou de gestion intégrative, diagnostics forestiers et rédaction de plans de gestion, projets de recherche appliqués (vieilles forêts et biodiversité du sol), réalisation de supports de vulgarisation et formations autour de la gestion forestière durable, l’IBP, notamment.

Cette diplômée d’un DESS en gestion de la planète, environnement et développement durable et d’un master en sciences de l’environnement en partenariat avec l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris, débute comme coordinatrice environnement chez Lafarge. Elle travaille ensuite en tant que responsable qualité-sécurité environnement au sein de Vicat, puis chez Suez Environnement. Elle poursuit sa carrière dans l’assurance en devenant souscriptrice risques environnementaux chez Axa Corporate Solutions puis responsable des risques environnementaux chez Chubb en 2011. Retour chez AXA en 2018, ou elle officie en tant que responsable des risques environnementaux France et Benelux chez AXA XL. Elle est ensuite promue au groupe en 2021 au rôle de Responsable de la souscription durable.
Avec plus de 20 ans d’expérience dans les problématiques environnementales et 17 ans d’expérience dans l’assurance, Aurélie se concentre aujourd’hui sur l’intégration de la stratégie durabilité, Climat, Nature & biodiversité dans les activités d’assurance IARD du Groupe AXA. Cela englobe notamment la stratégie de décarbonation, les politiques de durabilité applicables à la souscription et le développement de produits d’assurance et de services liés à la nature et la biodiversité.

Titulaire d’un doctorat en génétique des populations, Téo Fournier est aujourd’hui responsable du pôle Solutions & Services chez GenoScreen, entreprise experte en génomique microbienne appliquées à la santé humaine, animale et environnementale. Il pilote le développement stratégique de solutions pour la caractérisation des microbiotes, en particulier dans le domaine de la santé des sols. À l’interface entre la recherche, l’innovation technologique et les besoins opérationnels des clients, il accompagne les partenaires industriels et académiques dans la mise en œuvre de projets fondés sur des données robustes, compréhensibles et directement actionnables.

Silvère Fredaigue est un ingénieur doté d’une carrière diversifiée en France et à l’international, spécialisé dans les domaines du marketing et de la gestion commerciale. Il a principalement œuvré dans les secteurs de la fertilisation, de la nutrition animale et de la distribution agricole. Actuellement, il occupe le poste de Responsable commercial et marketing chez Coopérative CAMN à Nantes, en France.

Chercheure au BRGM depuis 2010, Jennifer est spécialisée en écologie et écotoxicologie microbienne avec une focalisation sur les interactions entre communautés microbiennes et polluants (organiques et inorganiques) dans les sols et les eaux souterraines. Depuis 2010, son activité s’est orientée sur le développement et l’application de bioindicateurs microbiens dans différents contextes de pollution ou de réhabilitation de sites miniers et industriels, à travers des projets de recherche appliquées et fondamentales. Elle est fortement impliquée dans les réflexions sur l’intégration des fonctions écologiques et leur prise en compte dans la gestion des milieux à l’ère des réflexions de prise en compte de nouveaux indicateurs des eaux souterraines dans la directive cadre sur l’eau et l’actualité de la proposition d’un projet de directive cadre sur les sols.

Mickael Hedde, écologue, directeur de recheche à INRAE UMR Eco&sols
Les recherches de Mickael Hedde sont centrées sur l’écologie des organismes des sols. Elles visent à comprendre les facteurs qui déterminent la présence et la diversité des organismes des sols, leurs interactions et les fonctions écologiques associées à leurs activités. Initialement centrés sur la macrofaune des sols, ses questions prennent maintenant en compte la diversité multi-trophique et les réseaux d’interactions écologiques de l’ensemble des organismes du sol. Les agroécosystèmes sont son terrain de jeu principal, l’étude des milieux (semi-)naturels lui permettent de replacer ses résultats au sein d’une plus large gamme d’écosystèmes.

Responsable ‘Stratégie Goodsoil’ ayant pour objectif une meilleure connaissance du sol et la préservation de l’ensemble de ses fonctionnalités.
Facilitateur sol : accompagnement aux professionnels et particuliers sur la législation sol actuelle ainsi que sur les outils développés pour la ‘stratégie goodsoil’.
Expert sol : conseils techniques en pédologie et en remédiation des sols dégradés.
Membre du board de la SSSB (Soil Science Society Belgium)

Diplômée de Sciences Po Paris en affaires publiques, de Paris I Panthéon-Sorbonne et du master de philosophie de PSL (ENS-Ulm), Margot Holvoet a un temps travaillé dans l’édition, en parallèle de plusieurs responsabilités associatives (notamment au Shift Project). Depuis plusieurs années, elle dirige des associations environnementales : d’abord France Nature Environnement Ile-de-France et désormais, l’Institut de la Transition foncière.

Battle Karimi est directrice scientifique de Novasol Experts, bureau d’étude qui dispose de l’expertise pour évaluer la qualité écologique des sols. Diplômé d’un doctorat en écologie microbienne des sols, elle a mené des recherches sur la microbiologie des sols à l’échelle de la France pendant 5 ans au sein de l’institut INRAE à l’UMR Agroécologie de Dijon. Ses travaux ont donné lieu à de nombreux articles dans des revues académiques internationales et à la production d’un ouvrage de référence sur la biodiversité du sol « L’Atlas français des bactéries du sol ». Elle met désormais son expertise en écologie des sols et en écologie microbienne au service des usagers des sols pour une meilleure prise en compte du patrimoine biologique des sols dans la gestion de ces derniers.
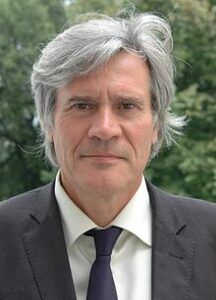
Petit-fils d’agriculteur, il est titulaire d’un BTS Tradicopa (transformation, distribution et commercialisation des produits agricoles) obtenu au lycée agricole d’Amiens Le Paraclet, d’une maîtrise et d’un DEA d’économie (1988) de l’université de Nantes, ainsi que d’un diplôme professionnel spécialisé au Conservatoire national des arts et métiers (1993).
Il est ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt de 2012 à 2017, fonction qu’il cumule avec celle de porte-parole du gouvernement à partir de 2014, sous la présidence de François Hollande.
Réélu député en 2017, il quitte l’Assemblée nationale l’année suivante, après son élection comme maire du Mans.

Lilian Marchand a démarré sa carrière au laboratoire d’Ecologie BIOGECO (Univ. Bordeaux/INRAE). Il travaille désormais au LyRE – un des centres d’innovation du groupe SUEZ basé à Bordeaux– où il travaille notamment sur le suivi et la réhabilitation écologique des sols dégradés ainsi que sur la création et le suivi de zones de rejet végétalisées.

Directeur de recherche à INRAE de Dijon, je suis spécialiste de l’écologie microbienne du sol. Mes travaux portent sur le rôle de la diversité des communautés microbiennes dans le fonctionnement du sol. Avec plus de 90 articles publiés dans des revues scientifiques de haut niveau, mon expertise est reconnue au niveau national et international. J’ai à cœur de la transférer aux agriculteurs, aux citoyens et aux pouvoirs publics pour contribuer à la prise de conscience de l’importance de la biodiversité des sols pour relever les défis associés à la transition vers des systèmes plus durables en milieu agricole et urbain.

Titulaire d’un doctorat en agrochimie de l’Institut National Polytechnique de Toulouse, Christian Mougin exerce ses activités au sein de l’Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement (INRAE) sur le Campus Agro de Palaiseau où il est Directeur de Recherche. Ses recherches concernent le développement de biomarqueurs d’écotoxicité, les mécanismes de biotransformation des xénobiotiques, la dynamique des contaminants organiques dans l’environnement, et plus globalement leurs effets sur le vivant. Recruté en 1992 au sein de la Station de Phytopharmacie de Versailles dont il a été animateur de l’équipe xénobiotiques et environnement de 2001 à 2006, il a été directeur de l’unité PESSAC de 2007 à 2014 et exerce actuellement au sein de l’UMR Ecosys. Il est directeur scientifique de la plateforme Biochem-Env depuis 2012. Il occupe également des fonctions d’animation au niveau national comme co-animateur du réseau d’écotoxicologie terrestre et aquatique (Ecotox), et de pilotage d’Infrastructures de Recherche : animateur du pilier Environnement de RARe (Ressources Agronomiques pour la Recherche) et du réseau de Plateformes Analytiques et outils mobiles d’AnaEE-France (Analyse et Expérimentation sur les Ecosystèmes). Il est également impliqué dans l’édition scientifique, l’expertise en écotoxicologie et la normalisation internationale de méthodes pour l’évaluation de la qualité biologique des sols.

Benjamin Pauget est le responsable du pôle Recherche et Développement chez Tesora.
Après avoir réalisé son doctorat à l’université de Franche comté sur l’influence des paramètres des sols sur les transferts de contaminants métalliques, il a participé à plusieurs projets de recherche visant à améliorer la caractérisation des risques environnementaux via l’utilisation de bioindicateurs. Il a notamment contribué au développement de l’indice SET, un outil d’évaluation de la biodisponibilité des contaminants des sols grâce à l’escargot Cantareus aspersus. Benjamin a ensuite rejoint Tesora, un bureau d’étude en ingénierie environnementale spécialisé dans la gestion des pollutions et de la revalorisation de sites à passifs environnementaux. Au sein de Tesora, il dirige le pôle recherche et développement dans lequel ses axes de recherche portent principalement sur le développement d’outils numériques et sur l’élaboration de nouvelles méthodologies d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux. Par exemple, il travaille activement sur la simplification et la démocratisation de la norme TRIADE : le projet de recherche TRIPODE en partenariat avec l’INERIS a permis la diffusion d’un guide d’application de la démarche TRIADE à destination des acteurs de la gestion des sites à passifs environnementaux pour améliorer la prise en compte des risques environnementaux.

Christophe Poupard occupe le poste de directeur de la connaissance et de la planification à l’agence de l’eau Seine-Normandie. L’agence de l’eau est un établissement public du ministère chargé de l’environnement, qui œuvre pour la restauration de la qualité des milieux aquatiques et des eaux souterraines.
Il a auparavant occupé plusieurs postes dans les administrations de l’Etat chargées de l’agriculture et de l’environnement, à la fois au niveau central et au niveau régional. Il était ainsi précédemment sous-directeur de l’économie des ressources naturelles et des risques, au Commissariat général au développement durable. Il a représenté la France au comité des politiques de l’environnement de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), ainsi qu’au panel international d’experts sur les ressources du PNUE (Programme des Nations-Unies pour l’environnement).
Actuellement, la mission de son équipe est de décrire l’état des ressources en eau, les pressions auxquelles elles sont soumises, les stratégies de restauration à mettre en place (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) ainsi que les actions concrètes à mener, sur le territoire de la Seine, de ses affluents et des fleuves côtiers normands. Elle a également préparé la mise à jour de la stratégie d’adaptation de ce territoire au changement climatique, adopté en 2023 par le Comité de bassin Seine-Normandie.

Léa Pourchier a rejoint la Fédération des Parcs naturels régionaux de France fin 2024, où elle occupe le poste de chargée de mission énergie, biodiversité et sols. Son travail s’articule autour de deux projets principaux : d’une part, elle pilote une action du programme LIFE BIODIV France, visant à intégrer les enjeux de biodiversité dans le développement des énergies renouvelables au sein des aires protégées ; d’autre part, elle accompagne, avec le soutien de l’ADEME, les PNR dans les enjeux de préservation, de gestion durable et de restauration des sols.
Diplômée de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et issue d’un parcours en coopération internationale, Léa a acquis plusieurs expériences en ONG, autour de thématiques connexes à celles qu’elle traite aujourd’hui : valorisation et préservation des patrimoines naturels. Elle a progressivement souhaité recentrer son engagement sur les dynamiques territoriales françaises. Son intérêt pour les échelles locales, la mobilisation des acteurs et les démarches de transition l’a naturellement conduite vers le réseau des Parcs naturels régionaux, qu’elle considère comme un levier concret et pertinent pour répondre aux enjeux écologiques contemporains.

Ingénieure agronome, avec une formation complémentaire aux SIG, elle a participé au programme Inventaire Gestion et Conservation des Sols IGCS du GIS Sol qui a conduit à l’élaboration des bases de données sur les sols d’Alsace en collaborant avec des pédologues. Elle est aujourd’hui responsable de l’équipe sols et fertilité au sein du service Multi performance et transitions agricoles de la Chambre régionale d’Agriculture Grand Est. Elle est impliquée dans la diffusion et la valorisation des informations sur les sols, à travers notamment le pilotage du RMT Sols et Territoires (https://sols-et-territoires.org/) et divers projets R&D (https://grandest.chambres-agriculture.fr/sadapter-aux-transitions/fertilite-des-sols).
Le Réseau mixte technologique Sols et Territoires s’adresse aux acteurs des territoires pour une meilleure connaissance des sols et de leur multifonctionnalité. Il facilite l’utilisation de l’information sur les sols et participe à la traduction opérationnelle des résultats de la recherche. Il propose des actions favorisant l’accès aux données à l’aide d’outils ou de méthodes adaptés aux besoins des acteurs concernés par la gestion et l’utilisation des sols dans toute leur diversité. Il ambitionne de répondre aux besoins croissants de connaissance des sols à des niveaux de résolution fins, par l’innovation dans les méthodes de cartographie des sols, mobilisant la modélisation statistique et les nouvelles technologies (apport des capteurs en proxy et télédétection), ou par le développement des sciences participatives pour l’identification des sols au niveau parcellaire. Le RMT anime un réseau d’acteurs de la connaissance des sols, pour favoriser la mise en place d’une chaîne cohérente des expertises à diverses échelles (locales-régionales-nationales) et le maintien sur les territoires d’une expertise pédologique opérationnelle. Il apporte également son soutien aux actions de formation et aux acteurs de la formation qu’elle soit initiale ou continue, pour un public agricole mais également plus large.
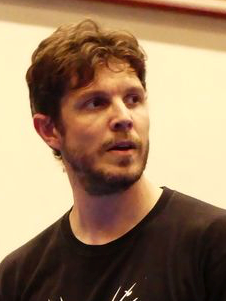
Après une thèse de doctorat soutenue en 2010 et un post-doctorat en bioinformatique, Sébastien TERRAT a intégré l’UMR 1347 Agroécologie en 2014 en tant qu’enseignant-chercheur. Sa thématique de recherche se focalise sur la détermination des processus et filtres de la distribution spatiale des communautés microbiennes du sol à différentes échelles, mais aussi vise à déterminer le rôle de cette diversité microbienne dans le fonctionnement biologique du sol. Son expertise en écologie microbienne, en biologie moléculaire et en bioinformatique lui permet d’être impliqué dans plusieurs projets de recherche qui donnent lieu à la publication de plusieurs articles scientifiques dans des revues internationales mais aussi d’être un des auteurs d’Atlas sur les communautés microbiennes des sols comme « L’Atlas français des bactéries du sol » sorti en 2018, ou « L’Atlas français des champignons du sol » en 2024.

Matthieu Valé est ingénieur agronome (ENSAIA, 2002) et docteur en Agronomie (INRA Toulouse, 2006). Ses travaux de thèse portaient sur la quantification et la prédiction de la minéralisation nette de l’azote du sol in situ, sous divers pédoclimats et systèmes de culture français (co financement ARVALIS / Terres Inovia).
Depuis 2007, il est responsable scientifique du pôle Agriculture au sein d’Auréa AgroSciences, laboratoire agronomique filiale d’ARVALIS Institut du Végétal. Ses missions portent notamment sur la mise en place d’analyses innovantes (physique et biologie du sol). Il collabore régulièrement avec les Instituts de recherche (INRAE, IRSTEA) et les Instituts techniques (ARVALIS, ASTREDHOR) dans le cadre de projets de recherche et développement (Projets CASDAR Microbioterre, OPTIFAZ, PHOSPHOBIO, IDTYPTERRES). Depuis novembre 2017, il anime le groupe « Fertilité Organique et Biologique des Sols » du COMIFER.
Il coordonne le projet AGRO-ECO SOL (2017-2023), qui vise à développer une filière technique et économique sur le diagnostic et le conseil pour une gestion agroécologique des sols cultivés, en collaboration avec l’INRAE et ARVALIS. Le projet AGRO-ECO SOL est accompagné par l’ADEME dans le cadre du programme Industrie et Agriculture éco-efficientes du programme des Investissements d’Avenir.

Alan Vergnes est enseignant-chercheur à l’Université Paul-Valéry et au CEFE où il étudie la grande faune du sol (vers de terre, fourmis…) en contexte urbain. A ce titre, il coordonne divers projets menés en étroite collaboration avec les collectivités et autres parties prenantes, comme le projet ANR BISES (Biodiversité des sols urbains) et le LLunam (Living lab Solutions fondées sur la nature dans l’aire urbaine de Montpellier).

Cécile Villenave, ingénieure diplômée d’AgroParisTech et docteure en écologie, a travaillé 20 ans en tant que chercheuse à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) sur l’étude du rôle des organismes du sol dans les agrosystèmes : vers de terre, nématodes phytoparasites, nématodes libres. Forte de son expertise scientifique, elle cofonde en 2011 ELISOL environnement aux côtés de deux associées. Aujourd’hui, elle en assure la direction scientifique.
ELISOL environnement est une entreprise à l’ancrage scientifique solide, spécialisée dans la santé des sols et des plantes. Reconnue à l’échelle internationale pour son expertise sur les nématodes du sol, ELISOL fournit à ses clients des analyses biologiques permettant d’évaluer et de surveiller la santé biologique des sols. Ces diagnostics s’appuient sur l’étude des nématodes, bio-indicateurs essentiels de la qualité biologique des sols.
Au-delà de son rôle d’expert en diagnostic biologique, ELISOL est également un laboratoire d’analyses phytonématologiques, un centre de recherche et développement, ainsi qu’un organisme de formation certifié Qualiopi, contribuant ainsi activement à l’innovation et à la formation.

Au cours de son parcours, il a acquis une solide formation en agronomie et agroalimentaire, explorant des thématiques majeures telles que l’agriculture durable, la gestion des ressources naturelles et l’écologie microbienne des sols. Son expérience compte également un volet technique en laboratoire, notamment dans l’analyse microbiologique et physico-chimique des sols. Par la suite, il a réalisé une thèse sur les communautés microbiennes de la rhizosphère en sols anthropisés, visant à améliorer les stratégies de phytoremédiation et à valoriser les sols contaminés. Actuellement, ingénieur de recherche à l’INRAE Dijon, il se focalise sur l’impact des modes de production viticole sur la biodiversité microbienne des sols, s’inscrivant dans une démarche de transition agroécologique. Grâce à une approche participative impliquant les acteurs du secteur, il contribue à développer un outil opérationnel permettant aux viticulteurs d’évaluer l’impact de leurs pratiques à l’aide d’indicateurs de la qualité microbienne des sols.